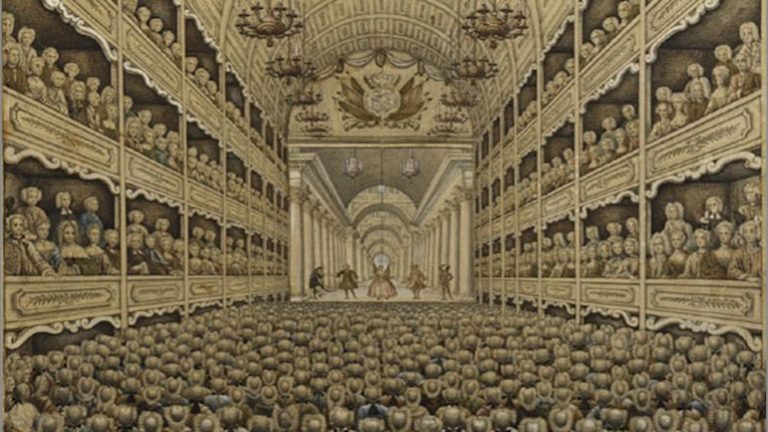Face à la crise écologique, que peut la poésie ?
Et si la littérature n’était pas un simple refuge face à la catastrophe écologique, mais un outil de transformation collective ? De l’épopée antique aux dizains de Pierre Vinclair, la poésie contemporaine explore un nouvel imaginaire. Une cérémonie poétique pour refonder nos catégories de pensée.
La littérature a, dès ses origines, voulu penser ensemble la nature et la politique. C’est notamment le cas du genre de l’épopée, comme l’Iliade, l’Odyssée ou, plus tard, l’Énéide. L’épopée cherche à travers les personnages qui représentent des choix politiques à fonder ou refonder la cité. Ainsi, dans l’Odyssée, le combat entre les prétendants qui veulent le pouvoir et Ulysse, le roi d’Ithaque qui doit faire valoir sa légitimité. L’épopée antique s’intègre dans une cosmologie, une vision de la nature, des dieux et des hommes, alors homogène. Le poète Frédéric Boyer a d’ailleurs intitulé sa traduction des Géorgiques, de Virgile, le Souci de la terre : pour les Anciens, la politique est dans la nature.
La poésie contemporaine renoue avec cette tradition, pour imaginer une autre vie politique face à la crise écologique. C’est le cas du poète Pierre Vinclair, dont je parlerai plus longuement dans cet article, mais aussi (par exemple) de Jean-Claude Pinson et Michel Deguy. Que peut dire, et faire, la littérature, la poésie, dans la grande crise écologique qui est la nôtre ? Deux choses essentielles : agir sur nos catégories de pensée, refonder un nouvel imaginaire, par exemple notre conception des relations entre nature et culture ; et inventer de nouvelles formes d’échanges et d’action collective pour donner vie à ce nouvel imaginaire. Il ne saurait donc être question de (seulement) célébrer la Nature ni de (seulement) dénoncer l’impasse actuelle, mais de (re)créer un ordre affectif et collectif.
Les sciences sociales ont assez montré combien nos représentations transformaient notre vie collective : les modèles d’action politiques (le capitalisme, le communisme, la social-démocratie, etc.) sont autant des idées que des pratiques sociales. Plusieurs livres de Pierre Vinclair, poète français né en 1982, tracent une voie pour créer du sens « face à la catastrophe ».
Le pouvoir de la littérature : changer les catégories de pensée
Pierre Vinclair a publié deux livres qui abordent directement la question écologique, un livre de poésie, la Sauvagerie (2020), et un essai, Agir non agir (2020).
La Sauvagerie est une série de 500 poèmes, inspirés sur la forme par l’œuvre d’un grand poète de la Renaissance, Maurice Scève, qui publia sa Délie en 1544. La Sauvagerie a paru dans « Biophilia », la collection que la maison d’édition Corti consacre « au vivant au cœur d’éclairages ou de rêveries transdisciplinaires ».
Une série de dizains (dix vers décasyllabiques rimés) se consacre aux espèces animales les plus menacées. Pierre Vinclair recourt à la métaphore de la cuisine, pour expliquer sa poétique : ses dizains qui rassemblent une vaste érudition littéraire et scientifique cherchent à faire déguster au lecteur un « plat vivant ». Pour entrer en cuisine, rien de mieux que de lire, et relire, un dizain ; par exemple celui consacré à une espèce d’albatros, Diomedea Amsterdamensis, qui vit dans l’océan Indien. La figure de l’albatros rappelle immédiatement Baudelaire, où l’oiseau symbolisant le poète plane dans le ciel (les albatros ne se posent presque jamais) mais une fois à terre ne peut rien contre la cruauté des hommes qui l’agacent avec un briquet. Voici le dizain de Pierre Vinclair :
« Souvent, pour s’amuser, trois hommes violent
un albatros, gros oiseau indolent
coincé dans les ralingues des palangres
où l’attire une fish facile (avec aplomb,
le poète semblable au pêcheur dont les lignes
piègent des vivants, en a lancé vers l’internet
et lu : albatros – the female proceeds to receive
anal, while jacking off sb with both hands)
l’oiseau sombre, comme un plomb dans la mer
acorant son poussin abandonné. »
Le poète est une espèce menacée comme toutes les espèces le sont, et un « pêcheur contre les pêcheurs » ; l’albatros, lui aussi une espèce menacée, est pareillement poète : la métaphore est réversible. Le poème joue sur les signifiants, puisqu’en argot américain l’albatros est une position sexuelle – le dizain porte le numéro 69. La pornographie est donc la menace qui écartèle Diomedea amsterdamensis, piégé en pourchassant les poissons dans les palangres de la pêche industrielle. Un drame se joue : l’oiseau sera-t-il sauvé ?
Dans le dernier vers, il sombre, et accuse d’abord ses tortionnaires, et le poète qui ne l’a pas sauvé mais donne à voir, à sentir, le drame ignoré d’un oiseau. En somme, l’oiseau invite les lecteurs à son procès, le nôtre, pour meurtre et pornographie ; notre désir viole l’ordre du monde, le viol de la femelle ne donnera naissance à rien, le poussin abandonné va mourir et l’espèce avec lui.
La poésie est une pensée non pas philosophique ou scientifique, avec des concepts, mais avec figures (ici l’oiseau, les pêcheurs, le poète, les navires-usines, le désir, la pornographie). Elle n’est pas sans ordre, elle est tenue par la versification, la prosodie, l’architecture de la langue.
La poésie, ou la cérémonie improvisée
La poésie (et Vinclair) pense aussi l’organisation de la vie collective face à la catastrophe. Le moyen poétique, c’est l’épopée parce que celle-ci cherche justement à faire vivre un changement politique, on l’a vu. La Sauvagerie est donc une épopée du monde « sauvage ». Mais nous sommes modernes ; l’épopée sera donc fragmentaire puisque nous n’avons plus de récit qui garantirait l’unité du monde comme en avaient les Anciens Grecs. La Sauvagerie est une épopée collective pour Gaïa, le nom que donne le philosophe Bruno Latour à la nature pour sortir de la dichotomie mortifère entre nature et culture. Gaïa englobe aussi bien humains que non-humains dont le destin est commun.
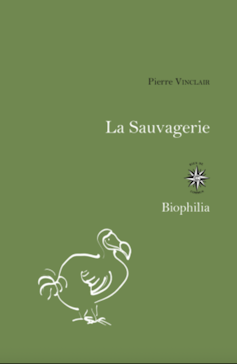
Il faut alors d’autres modes d’action collective, et Vinclair a invité d’autres poètes qui écrivent aussi des dizains, se commentent, dans une sorte d’atelier de peintres de la Renaissance. La Sauvagerie est donc une œuvre collective, et Vinclair invite dans cet atelier tous ceux qui veulent contribuer à la refondation de notre vie imaginaire et sociale, des artistes aux scientifiques. La catastrophe en cours nous oblige à repenser, réorganiser, notre vie symbolique mais aussi nos moyens d’agir. Le poète ouvre les portes d’une maison (de mots, nous habitons le langage comme le langage nous habite) où le lecteur peut rencontrer le(s) poète(s), d’autres lecteurs, des albatros, Baudelaire, des pêcheurs, des navires-usines, dans une architecture (une forme), un théâtre commun parce que la vie sociale est une dramaturgie : c’est donc bien une « cérémonie improvisée », un rite, où le sujet « délaisse ses contenus propres, se laisse posséder par les gestes d’un mort servant de médium » pour recréer le sens.
Cette cérémonie convoque humains et non-humains dans un espace et un lieu commun pour célébrer justement ce que nous avons en commun, dont aussi, point capital pour Vinclair, les morts, afin de reconstruire la chaîne des générations et de la vie (pour tous les êtres vivants). Le poème organise cette cérémonie pour sortir ensemble de ce que l’anthropologue Philippe Descola appelle le « naturalisme » : l’idée, moderne, où le monde n’est que matière, et par là, matière à notre disposition, à l’exploitation, jusqu’à la catastrophe. Le grand poète romantique allemand Hölderlin interrogeait : « À quoi bon des poètes en temps de détresse ? » La réponse vient : à ça, justement.![]()
Sébastien Dubois, Professor, Neoma Business School
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.